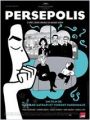La mise en scène de Stanislas Nordey de ce classique de Camus aligne du beau monde dans la grande salle de La Colline : Emmanuel Béart et Wajdi Mouawad pour ne citer qu’eux. Refroidi par l’expérience du Tramway à l’Odéon où grande star ne rime pas avec théâtre de qualité, je craignais le pire. Et le pire est arrivé, sous une forme différente, plus posé (on était loin du défilé de mode), plus discret, par un ennui pesant qui s’installe pendant deux heures et demi… 150 minutes (ou presque, si on fait abstraction du sursaut des 15 dernières minutes) où 5 personnages, habillés en manteaux gris dans un décor inexistant, déclament un texte puissant mais sans vie, comme une longue récitation où les sursauts d’émotion font rire au lieu de pleurer et où le drame se transforme en concours de voix enrouées. Le théâtre de la Colline a vu mieux, les applaudissements polis en témoignent. Tristement banal. (note : 2/5)
Voyage au bout de la nuit
La lecture du roman culte de Céline est en premier abord poussive et donne l’impression de ramer à contre courant dans un fleuve déchainé. Petit à petit, un malaise s’installe, ce personnage lâche et cynique qu’est Ferdinand Bardamu ne cesse de se heurter à l’absurdité du monde qui l’entoure fait de guerres, de faux héroïsmes et de recherche de l’argent et du plaisir. On finit aussi par se rendre à l’évidence que le thème de la nuit est omniprésent et que l’action semble se dérouler dans une pénombre sans fin : la première guerre mondiale ressemble à une succession de fuites nocturnes, l’expérience américaine finit dans des déambulations nocturnes, Rancy qui vit dans la pénombre, l’asile de Vichy vit la nuit… Le monde que met en scène Céline réduit l’homme à un animal enragé, les visages sont gris, les destins tristes à mourir, le soleil ne s’y lève pas, mais ce monde est affreusement réaliste et inquiétant. Après ce « voyage », le lecteur a aussi l’impression d’être arrivé au bout de la nuit… Oui, c’est de la grande littérature! oui, Céline est un des grands écrivains français de son siècle. A lire. (note : 5/5)
Siddharta
Preljocaj revient avec une nouvelle création pour l’Opéra de Paris, le ballet Siddharta inspiré du mythe de celui qui donnera naissance au Bouddhisme. La courte description sur le site de l’Opéra est accrocheuse : « au-delà du simple récit, il dévoile les tourments et les mystères de ce long voyage intérieur, semé d’embûches, d’incertitudes et de doutes. » Malgré un début prometteur, on finit vite par ne plus reconnaitre ce qui fait la force d’un Preljocaj : les gestes sont imprécis (c’est vrai que l’Opéra de Paris n’est pas le temple de la danse contemporaine), la musique est insignifiante ou agaçante, la scénographie sans intérêt… ou ridicule comme dans cette scène où l’Éveil apparaît dans un halo de lumière devant une énorme maison pendue au ciel… Tout cela finit par de timides applaudissements, on se hâte de quitter la salle et d’oublier qu’il s’agissait d’un Preljocaj. (note : 2/5)
Chroniques japonaises #2
Un Tramway… (film)
Après la déception de la version au théâtre mise en scène par Warlikowski (cf. infra), et avant de porter un jugement infondé sur le texte de Tennessee Williams (que je n’ai pas lu), j’ai vu le film éponyme signé Elia Kazan avec Vivien Leigh et Marlon Brando… Difficile de ne pas faire un parallèle entre (a) la platitude des personnages de la pièce où l’intrigue est centrée sur l’héroïne super-star, les autres personnages servant de décor à ce qui est vite devenu un défilé de mode et (b) les reliefs des personnages du film, la complexité de leurs interactions, l’évolution inexorable vers la folie et la contribution de chacun à cette dérive. D’un même texte, d’une même histoire, le théâtre (pourtant avantagé par une proximité et une liberté qui font défaut au cinéma) échoue là où le cinéma nous livre un film superbe. Warlikowski n’est pas Kazan… Le premier à éviter, le second à voir (note : 5/5)
Chroniques japonaises #1
Voici une nouvelle rubrique, chroniques japonaises, inspirée d’une série de photos prises lors de mon unique voyage dans ce pays fascinant. Et pour commencer, le japon ultra-moderne, celui grouillant qui ne dort jamais avec ce cliché du carrefour géant du quartier nocturne de Shibuya.
(carnet de voyage complet sur firas.fr)
Shutter Island
Le dernier Scorsese avec DiCaprio vient de sortir. On regarde la bande-annonce et on s’y précipite. Le début du film est à la hauteur des attentes, deux agents fédéraux viennent enquêter sur une disparition mystérieuse dans une île-prison pour criminels fous. La loi du silence y règne, les personnages ont tous des têtes étranges. Mais l’intrigue s’enlise et perd petit à petit en efficacité… S’y ajoute une pseudo-dimension historico-morale qui vient souvent comme un cheveu sur la soupe. On tourne en rond autour d’une fin « surprise » dans le style du 6ème Sens, mais en moins bien. Au lieu d’une fin grandiose, on est finalement contents quand les lumières se rallument. Moyen. (note : 3/5)
La Rumeur des Steppes
« René Cagnat, ancien diplomate, vit aujourd’hui dans cette zone de fracture qu’est l’Asie centrale et enseigne à l’université de Bichkek, en Kyrghyzie ». Les premiers mots de la quatrième de couverture disent déjà l’essentiel. Une fois qu’on a regardé une carte pour « se rappeler » où se trouve la Kyrghyzie (dont certains ne soupçonnaient pas l’existence avant d’avoir vu le mot), on commence timidement la lecture de cette histoire d’une zone méconnue du globe. L’écrivain n’est ni romancier ni un représentant de cette nouvelle espèce de faux aventuriers qui nous racontent des histoires de traversées de globe en chien de traineau (en oubliant de citer l’hélicoptère qui les transportait entre deux étapes). René Cagnat, passionné par les rencontres humaines, nous raconte cette région du globe qu’il a découverte il y a quelques décennies et à laquelle il a développé un attachement particulier. Des fresques historiques de Gengis Khan et Tamerlan aux conséquences encore visibles d’un siècle de communisme, l’histoire est racontée sans fioritures, parfois en désordre ou avec un petit côté mélodramatique qui traduit plutôt une spontanéité et un immense attachement qu’une réelle volonté de tomber dans l’affectif. Loin de la froideur d’un simple récit historique, l’auteur nous fait vivre une rencontre, souvent triste mais remplie d’humanité. Merci M. B. pour cette belle découverte. (note : 4/5)
Persepolis
Marjane Satrapi nous raconte son histoire personnelle de la veille de la révolution iranienne à l’exil. Film animé adapté de la bande dessinée éponyme, à la fois drôle et émouvant, on y parcourt, entre rires et larmes, les événements tragiques de la révolution et l’instauration de l’obscurantisme du régime des mollahs. Terriblement accrocheur malgré quelques longueurs. (note : 4/5)
Valse avec Bachir
Valse avec Bachir raconte, à travers des bribes de mémoire de jeunes soldats israéliens, des fragments de l’invasion du Liban par Israël en 1982 pour y déloger l’OLP du jadis peu fréquentable Arafat. Le travail de mémoire (entre entretiens, flashbacks et souvenirs provoqués) est intéressant et la représentation animée qui en est faite esthétiquement accrocheuse. En revanche, la dimension historico-politique propre à toute guerre y est représentée d’une simplicité déconcertante : les Israéliens sont venus nettoyer le Liban de « terroristes » sans visages et assistent, par un concours de circonstances, à un massacre de civils palestiniens perpétré sous leurs yeux par de méchants phalangistes… Comme ce monde parait si simple… On se demande alors si cette simplicité relève d’une vision personnelle du réalisateur, de l’inconscience collective qui a construit ce mythe ou de la propagande grossière. Peut-être un mélange des trois ? Dommage, ne s’agissant pas d’un Walt Disney, cette vision manichéenne et partiale d’un évènement d’une telle gravité nuit au travail d’ensemble. (note : 2/5)