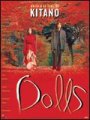Nous vivons encore un grand moment de communication mondiale… D’un côté, les gentils : les « olympistes » (fervents croyants dans les valeurs universelles non mercantiles des JO), les comités olympiques, le régime chinois, les sponsors, etc. De l’autre, les méchants : reporters sans frontières, les che guevara modernes qui veulent libérer le Tibet, les boycotteurs…. Tout de suite, chacun sort les grands mots, comme à la bonne vieille époque de guerre froide où tout désaccord devenait d’ordre moral : les chinois parlent de blasphème, Sarko parle de tristesse, le CIO parle de haine, on crie, on pleure, vite, cachons la flamme dans un bus avant que le rêve ne s’éteigne.
Entre ces deux extrêmes, la grande majorité des gens regarde, atterrée, ces images où de jeunes rêveurs se font tabasser par des flics (en France…) parce qu’ils soufflaient leurs idéaux sur une torche en plastique… entend ces discours creux d’une hypocrisie honteuse prononcés par chaque bord qui ne voit que sa propre vérité. J’en fait partie, de cette majorité désolée de voir où nous en sommes… et je me pose une seule question : quel est le sens de cette immense mascarade ?